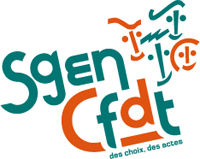On sait que cette question est un des sujets clés de la polémique qui oppose les “républicains” (présentés aussi comme des “déclinologues” de l’école) et les pédagogues.
La DEPP, la direction des études statistiques de l’éducation nationale a publié - après bien des difficultés semble t-il - les résultats d’une enquête de 2007 reprise d’une enquête de 1987, portant sur la lecture, le calcul et l’orthographe en fin de CM2. (Téléchargeable en cliquant ici)
Cela permet de comparer les performances des élèves à vingt ans d’intervalle (avec des repères intermédiaires), à partir des résultats observés aux mêmes épreuves. On constate sur vingt ans une baisse significative des performances des élèves dans les trois compétences qui font l’objet de cette enquête.
En lecture, les résultats sont stables de 1987 à 1997 ; en revanche, on observe une baisse significative du score moyen entre 1997 et 2007, plus prononcée pour les élèves les plus faibles. La situation est différente en calcul : une baisse importante des performances, touchant tous les niveaux de compétences, est observée de 1987 à 1999 ; puis, de 1999 à 2007, les résultats stagnent. Concernant l’orthographe, le nombre d’erreurs, essentiellement grammaticales, constatées à la même dictée a significativement augmenté de 1987 à 2007. Le pourcentage d’élèves qui faisaient plus de quinze erreurs était de 26% en 1987, il est aujourd’hui de 46%.
Ces résultats montrent donc une baisse de niveau plus marquée que dans l’enquête PISA, particulièrement sur le plan de l’orthographe. Ils montrent surtout un creusement des écarts. Cette baisse est en effet nettement plus marquée pour les élèves les plus faibles ( ainsi deux fois plus d’élèves - 21% - se situent en 2007 au niveau de compétence des 10% les plus faibles de 1987 ). En revanche les meilleurs élèves sont nettement moins concernés par cette tendance à la baisse, puisqu’ils sont encore 8% en 2007 à dépasser le niveau que les 10% les meilleurs dépassaient en 1987. On notera que la baisse constatée en lecture entre 1997 et 2007 n’a pas touché les enfants d’origines sociales favorisées.
Dans son blog (ici), Claude Lelièvre revient avec le regard de l’historien et du très bon spécialiste sur cette question de la baisse du “niveau”. Il rappelle d’abord que cette affirmation est vieille comme le monde et sujette à de nombreux débats et problèmes de mesure. Il rappelle aussi qu’ “il est pour le moins malaisé de rapporter ces évolutions à des politiques scolaires gauche-droite définies ”.
Il ressort aussi de sa bibilothèque le livre de Christian Baudelot et Roger Establet ( " Le niveau monte ; réfutation d’une vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles ", 1989). Ceux-ci après avoir noté que la fraction des 30% qui réussissaient le mieux aux tests d’incorporation les réussissaient plus que jamais dans les années 1980 attiraient en effet fortement l’attention sur le décrochage de la fraction des 20% qui réussissaient le moins ces tests, et de moins en moins... " Il reste encore aujourd’hui une quantité substantielle de jeunes qui sortent de l’école sans maîtriser les éléments fondamentaux d’un savoir minimum. L’élévation générale du niveau n’a exercé sur le leur aucun effet d’entraînement ; il n’y a aucune raison que la situation s’améliore tant qu’on comptera sur la hausse du plafond pour relever le plancher. La formule du SMIC culturel rompt, dans son réalisme modeste, avec la représentation dominante du libéralisme scolaire : elle oblige à ne plus considérer l’école depuis son sommet, mais à partir de sa base " , (op. cit. p. 195 ).